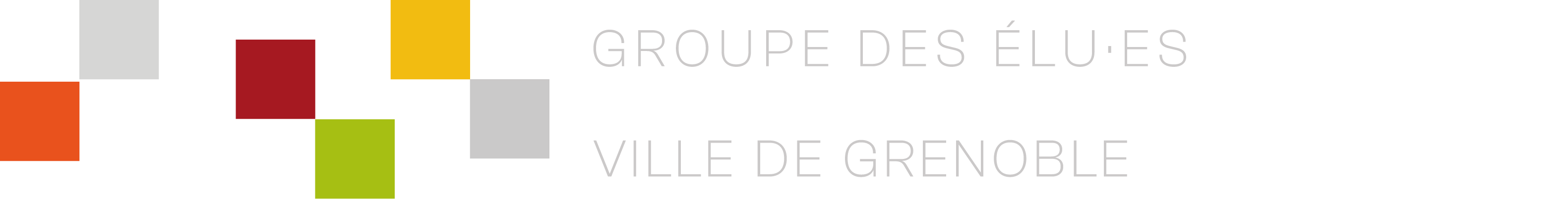A l’initiative d’un groupe de travail autour de la désertification médicale, présidé par le député de la Mayenne Guillaume Garot, une proposition de loi transpartisane a pu émerger pour répondre au défi crucial de la lutte contre les déserts médicaux et de la répartition équitable de l’offre de soin sur le territoire français. Notre vœu s’est donc construit autour de celle-ci.
Prendre en compte les nouveaux besoins des médecins
Notre vœu insiste sur un double facteur. D’une part, 31,1 % des médecins en activité ont plus de 60 ans et le nombre de médecins retraités actifs – celles et ceux qui continuent de pratiquer pour pallier un manque d’offre de soin – baisse continuellement depuis 2016. D’autre part, les modes de vie des nouveaux médecins changent. Ils et elles aspirent de façon légitime à une meilleure qualité de vie, un recours plus fréquent au salariat, et une baisse du nombre d’heures travaillées. La combinaison de ces deux facteurs nous amène à penser que le départ à la retraite d’un ou une médecin ne pourra être comblé que par un nombre supérieur de jeunes médecins.
Les grandes villes sont aussi concernées par la désertification
Il serait aisé de penser que les déserts médicaux ne se limitent qu’aux territoires ruraux. Pourtant, notre commune souffre également d’une pénurie de médecins, notamment de médecins traitants. D’après une étude de la CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) de Grenoble, notre ville compte 6,1 médecins pour 10 000 habitants, contre 9,4 pour l’Isère, 9,1 pour la région Auvergne Rhône-Alpes, et 8,7 dans l’ensemble du pays. De plus, près de 49 000 grenobloises et grenoblois se seraient trouvés sans médecin traitant, ou bien avec un médecin traitant de plus de 60 ans en 2023.
Une prise en compte insuffisante d’un défi pourtant immense
Des réformes ont été menées après la crise covid pour faire face à cette situation d’urgence. En 2021, le numerus clausus est (enfin !) remis en question et la loi Valletoux (2023) permet quelques avancées marginales.
Les collectivités, de leur côté, s’impliquent sur cette question. Grenoble, en particulier, est volontariste : elle s’est emparé de la compétence santé sans qu’elle soit inscrite dans ses compétences obligatoires, en soutenant notamment des centres de santé et en menant un travail conjoint avec la CPTS de Grenoble et l’assurance maladie. Toutefois, nous considérons que les collectivités ne peuvent pas seules répondre à un problème d’une telle ampleur.
Réguler l’installation des médecins, favoriser le salariat
Il s’agit pour nous d’améliorer à court terme l’offre de soins médicaux dans les territoires sous-dotés, notamment par une meilleure répartition des médecins, en envisageant des mesures de régulation de l’installation des médecins, en formant mieux nos futurs soignants en démocratisant l’accès aux études de santé, en anticipant les besoins de formation à venir et en incitant à l’installation dans les territoires caractérisés par une offre de soins dégradée. Il s’agit également d’améliorer l’exercice des soins dans les territoires, notamment les conditions de travail des médecins, et de favoriser le développement du salariat pour les médecins, en particulier dans les centres de santé des zones sous-dotées.
Quand la droite espère un résultat différent avec les mêmes politiques
Par hasard des choses, le groupe OSCDDC (droite) a formulé un vœu sur le même sujet que notre intergroupe. Si nous avons partagé le constat d’un contexte urgent sur la question de l’offre de soin, les réponses données aux problèmes soulevés divergent fortement.
Ainsi, si notre proposition de régulation est un véritable choix politique de rupture avec le système tel qu’il est pensé depuis de nombreuses années, la droite propose, en fin de compte, de poursuivre comme avant, en “[sanctuarisant] les aides aux communes pour la création de maisons de santé, et [en accélérant] la révision des zonages de l’ARS pour la médecine générale.”
Tout d’abord, il s’agit d’un énième appel à fournir des aides à l’installation des médecins, alors que c’est exactement ce qui est fait depuis des lustres sans résultat concret. Ainsi, il est démontré que des moyens importants sont d’ores et déjà déployés (autour de 87 millions d’euros sur l’année 2016 à titre d’exemple, selon le travail parlementaire) sans fournir de résultats probants. De plus, ce vœu évoque des aides aux communes pour la création de maisons de santé, alors qu’aucune aide de l’État n’est fournie en la matière.